
FRANCHIR LE RIDEAU DE FER
Par Ioanis Deroide
Une première version de ce texte a paru en 2014 dans le défunt magazine en ligne More TV.
Dans les nombreuses séries d’espionnage produites en Angleterre dans les années 1960, le franchissement du Rideau de Fer offre un intéressant renouvellement du motif frontalier.
Au début des années 2010, le motif de la frontière, au sens de ligne séparant deux territoires distinctement gouvernés, a opéré un spectaculaire retour sur le devant de la scène sérielle dans deux genres à succès: la fantasy qui a décroché avec Game of Thrones son premier blockbuster télévisuel, et le policier version nordic noir, dont la formule a été fixée par la série suédo-danoise Bron / Broen, diffusée à l’international sous le titre The Bridge. Dans Game of Thrones, le Mur sépare le royaume des Sept Couronnes, où se déroule l’essentiel de l’action, des terres glacées et sauvages situées au-delà, où vivent les « sauvageons » du Peuple libre et les redoutables Marcheurs blancs. Dans Bron / Broen et ses multiples adaptations internationales, un cadavre découvert en travers de la frontière pousse deux enquêteurs de nationalité et de personnalité différentes à collaborer.
Depuis, les séries de frontières ont continué de séduire les sériephiles amateurs de science-fiction géopolitique (The Expanse), de dystopie (La Servante écarlate), de romance (la sud-coréenne Crash Landing on You), de drame familial historique (l’allemande Ku’damm 56 / Berlin 56 et ses suites) et même de comédie mélancolique (la toute récente saison 2 de Mo). Dans la catégorie des très grosses productions, il n’est pas anodin que la frontière – certes pas comme limite entre deux Etats – soit au cœur de la grande franchise de ces dernières années,Yellowstone, car celle-ci relève du western. Or, c’est par ce genre, dominant dans les premières années de la production sérielle états-unienne, que la frontière s’est faite une place récurrente sur le petit écran dans les années 1950. Certaines séries comme Mackenzie’s Raiders se sont même donné comme héros des patrouilleurs frontaliers.
Dans ces westerns classiques, quand on cherche à franchir la frontière (mexicaine, en l’occurrence), c’est le plus souvent pour fuir un danger, celui d’être arrêté par les forces de l’ordre. Une fois cette limite passée, le malfaiteur se trouvera hors d’atteinte du bras de la justice, ou du moins le croit-il. Le Mexique est en effet présenté comme un territoire plus ou moins sans foi ni loi où l’on n’a guère à craindre les poursuites policières ou judiciaires; il est opposé de manière caricaturale à l’État de droit qu’incarnent les États-Unis. Les westerns des années 1950 sont pleins de ces scénarios de fuite empêchée vers le Sud, surtout quand le héros est un (ex) ranger ou un chasseur de primes lancé à la poursuite de fugitifs comme dans The Lone Ranger (s01e33) ou Wanted Dead or Alive / Au nom de la loi (s01e14). Si nécessaire, le cow-boy justicier n’hésite pas à franchir lui-même la frontière, comme Cheyenne dans la série éponyme, qui retrouve dans une petite ville mexicaine les bandits qui viennent de dévaliser une banque aux États-Unis (« Border Showdown », s01e04).
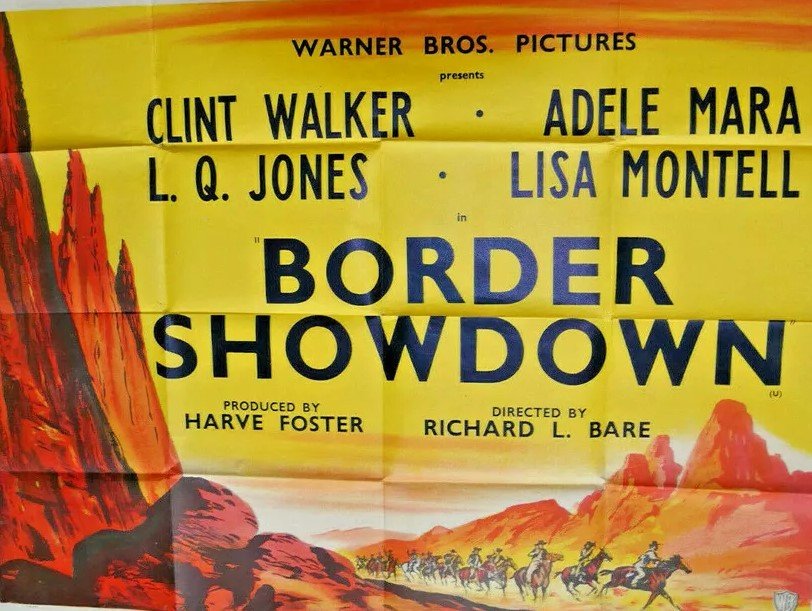
Cette séquence type du franchissement de la frontière a connu un intéressant renouvellement outre-Manche dans la décennie suivante. C’est ce moment britannique, inscrit dans le contexte de la guerre froide, qui va retenir notre attention, à travers une sélection d’épisodes qui témoignent d’une diversité de traitements.
Les années 1960 sont marquées par une double évolution. D’un côté, le western délaisse les cavalcades ainsi que la violence spectaculaire et s’éloigne de la frontière pour se replier sur des petites villes ou des ranchs plus propices au mélodrame. De l’autre, un nouveau genre s’affirme sur les deux rives de l’Atlantique: la série d’espionnage. Dans les productions britanniques, alors particulièrement en vue, la frontière joue un rôle récurrent mais renouvelé, puisque c’est désormais le héros qui est impatient d’arriver de « l’autre côté », plus exactement de revenir en lieu sûr au retour d’une périlleuse mission au-delà du Rideau de Fer. Le motif antérieur du desperado galopant vers le Rio Grande se trouve donc inversé : le voyageur fuit l’oppression et non plus la justice, il doit traverser une frontière protégée, surveillée, armée, et non plus déserte, poreuse, plus ou moins négligée. Les hasards de la géographie (celle des récits et celle des lieux de tournage) contribuent aussi à ce contraste. La frontière américano-mexicaine est chaude, ensoleillée, toujours aride et souvent montagneuse, et elle est figurée le plus souvent dans les ranchs de cinéma de la région de Los Angeles. Au contraire, le Rideau de Fer s’élève au milieu d’une plaine grise et froide, généralement humide et boisée, qui est recréée dans les studios d’Elstree ou dans les forêts environnantes.
Les épisodes de cette période regorgent de climax frontaliers parce que dans une Europe coupée physiquement en deux blocs antagoniques, le retour dans le « monde libre » peut aisément fournir un enjeu dramatique et générer du suspense. Les séries britanniques, héritières et contemporaines d’une abondante production littéraire et cinématographique d’espionnage, et destinées prioritairement à des spectateurs situés à moins de mille kilomètres du Mur de Berlin, aiment à mettre en scène régulièrement des incursions du côté Est, le temps d’une mission qui culmine dans le trajet du retour. Ce dernier acte forme en quelque sorte un récit d’évasion, soit un type d’histoires qui plaît beaucoup aux producteurs et aux spectateurs des années 1960-1970, au cinéma (La grande évasion, L’Evadé d’Alcatraz) comme à la télévision (Le Prisonnier, Colditz), notamment parce que le contexte de la guerre froide, dans la continuité de la Deuxième Guerre mondiale, perpétue l’idée de populations opprimées et captives dans des pays-prisons.
Dans ce contexte, nos héros britanniques doivent faire la preuve, par le succès de leur fuite, de leur supériorité d’individus libres sur des systèmes politiques et sociaux autoritaires fondés sur la surveillance et le contrôle.
Ils sont venus le plus souvent secourir un personnage plus faible : un fonctionnaire anglais abusé par les mensonges communistes (The Saint, s05e11) ou une ex-espionne qui a perdu la raison après avoir été torturée en RDA (Danger Man / Destination Danger, s02e05). Cette victime a généralement été arrêtée ou est sur le point de l’être et il convient de l’arracher des griffes de l’ennemi. À moins qu’il ne s’agisse surtout de rapporter de précieux documents confidentiels risquant de tomber entre de mauvaises mains. Une fois cette première partie de la mission accomplie, il reste encore à atteindre et franchir la frontière. Deux qualités sont alors requises : la ruse et la célérité.
Audace et vitesse
Dans Man in a Suitcase / L’Homme à la valise (s01e19), le premier de ces atouts est réduit à l’usage d’un gadget au moment crucial : le héros, McGill, réussit à semer l’automobile qui poursuit la sienne sur une petite route de forêt de RDA en actionnant une manette. Celle-ci libère un nuage d’épaisse fumée à l’arrière de son véhicule, aveugle les policiers est-allemands qui le pourchassent et les met finalement hors d’état de nuire. Pour le reste, tout n’est qu’audace et vitesse : McGill renverse d’un coup de portière le soldat venu le contrôler et, toujours au volant de sa voiture, enfonce la barrière du poste-frontière qui lui fait obstacle. Comme il se doit, il achève sa course sous les balles est-allemandes mais sans être touché, dans une de de ces scènes qui font dire aux rédacteurs de TV Tropes que les gardes-frontières de télévision (ou de cinéma) ont dû fréquenter la même école de tir que les stormtroopers de Star Wars.

En fait, dans Man in a Suitcase, la ruse est du côté des opposants au héros, dans cet épisode comme dans la série en général. McGill est un ex-agent secret américain qui travaille désormais à Londres pour son propre compte et il demeure mal vu par ses anciens employeurs et le monde du renseignement « officiel » dans son ensemble. De plus, il a souvent affaire à des clients peu scrupuleux. En bref, les conditions sont réunies pour qu’il soit fréquemment utilisé, manipulé, trompé dans un jeu dont il est souvent le seul participant intègre. En l’occurrence, dans l’épisode qui nous occupe, il est entouré notamment par un ancien nazi qui tente de se faire oublier et une espionne britannique prétendument passée à l’Est. Quant à sa mission, elle se révèle un véritable traquenard, de telle sorte que pour notre héros, passer la frontière revient à s’échapper d’un piège.
Le retour en lieu sûr est toutefois très relatif, les événements de l’épisode ayant confirmé à McGill qu’Est et Ouest se valaient en matière de manigances et qu’il ne pouvait décidément compter que sur lui-même. Dans la grande tradition du héros solitaire, il s’éloigne donc seul dans la dernière scène, plus apatride que jamais, n’emportant avec lui que la valise où tient toute sa vie et qui donne son titre à la série.
le maître de la frontière
Le sentiment dominant est bien différent dans l’épisode du Saint où le héros éponyme, Simon Templar à l’état civil, doit franchir lui aussi le Rideau de Fer (« Paper Chase »). Il y est encore question de mensonges et de manipulation mais la victime est cette fois un personnage secondaire, Eric Redman, un fonctionnaire du Foreign Office qui dérobe des documents confidentiels et part pour Leipzig parce qu’il a été abusé par la fausse promesse d’un escroc est-allemand. Il sera puni de son vol et sa naïveté en étant abattu au moment de repasser la frontière vers l’Ouest.
En revanche, pour Simon Templar, qui a rattrapé le voleur et entrepris de le ramener en Angleterre, toute cette affaire n’est qu’un jeu, dont l’issue est partiellement tragique – avec la mort de Redman – mais le déroulement jamais vraiment inquiétant, laissant même une place à l’humour et à la légèreté, surtout dans la première partie de l’épisode. C’est que le Saint multiplie avec aisance les ruses qui lui permettent de devancer ses ennemis, en l’occurrence la police est-allemande qui cherche aussi à mettre la main sur les documents britanniques. Ainsi, il vole une voiture de police pour déguerpir plus discrètement une fois les précieux papiers récupérés, puis enfile l’uniforme d’un officier (qu’il a laissé ligoté au bord de la route) pour tromper les gardes-frontières.

Si ces subterfuges qui consistaient à prendre l’apparence de l’ennemi pour mieux lui échapper échouent finalement, c’est seulement parce qu’il convient de laisser la place à une action plus périlleuse en fin d’épisode. La dernière partie du trajet, c’est-à-dire le passage de la frontière, se fait donc à découvert – quoique de nuit – à travers les barbelés, à la lumière des projecteurs des miradors et sous les balles, celles-là même qui sont fatales à Redman. C’est là qu’on retrouve le motif de l’évasion et celui de la chance qui sourit au héros en dépit de la vraisemblance, en même temps qu’on admire l’habileté du scénario et de la mise en scène qui construisent une scène d’action avec peu de moyens, une grande partie du cadre étant plongée dans l’obscurité, ce qui rend la frugalité des décors et l’artifice du studio moins flagrants. Au final, le coût pour Templar est quasi-nul : il a détruit les documents compromettants et revient sain et sauf en terrain sûr, qui plus est accompagné d’une charmante jeune femme, Hanya, qui a profité du savoir-faire de l’espion pour pouvoir quitter elle aussi la RDA. Certes, il est trempé (d’avoir traversé un cours d’eau frontalier), et le décès de Redman dans ses bras ne le laisse pas indifférent mais, au contraire de McGill, il est resté le maître du jeu du début à la fin.
franchir et faire franchir
La figure du héros maître de la frontière est poussée plus loin encore dans un épisode de Danger Man / Destination Danger où John Drake se paye le luxe de retourner la situation pour enfermer son opposant.
Dans « Fair Exchange » (s02e05), il est envoyé à Berlin avec pour mission de ramener au pays une ex-collègue espionne, Lisa Lanzig, partie en RDA pour assouvir une vengeance personnelle. Une fois sur place, Drake est confronté à l’impossiblité de franchir et faire franchir la frontière sur le chemin du retour, surtout une fois que Lanzig est recherchée par les autorités est-allemandes pour un meurtre qu’elle préméditait mais n’a pas commis. Comme le lui rappelle Pieter, un autre agent occidental sur place :
“There are soldiers everywhere ! There’s a double wire fence, each fence is electrified. There are mines. Everywhere !”
Ici donc, une fuite à la McGill ou à la Templar, tout en force ou en opportunisme, est inenvisageable. La frontière est décrite comme inviolable. Seul un plan réfléchi peut sortir d’affaire le héros. Celui de Drake est simple : attirer du côté ouest Wilhelm Berg, le fils du chef de la Sécurité mais aussi le véritable auteur du meurtre dont on accuse Lanzig, et procéder, comme l’indique le titre de l’épisode, à un « échange équitable » entre Berg et l’ex-espionne.
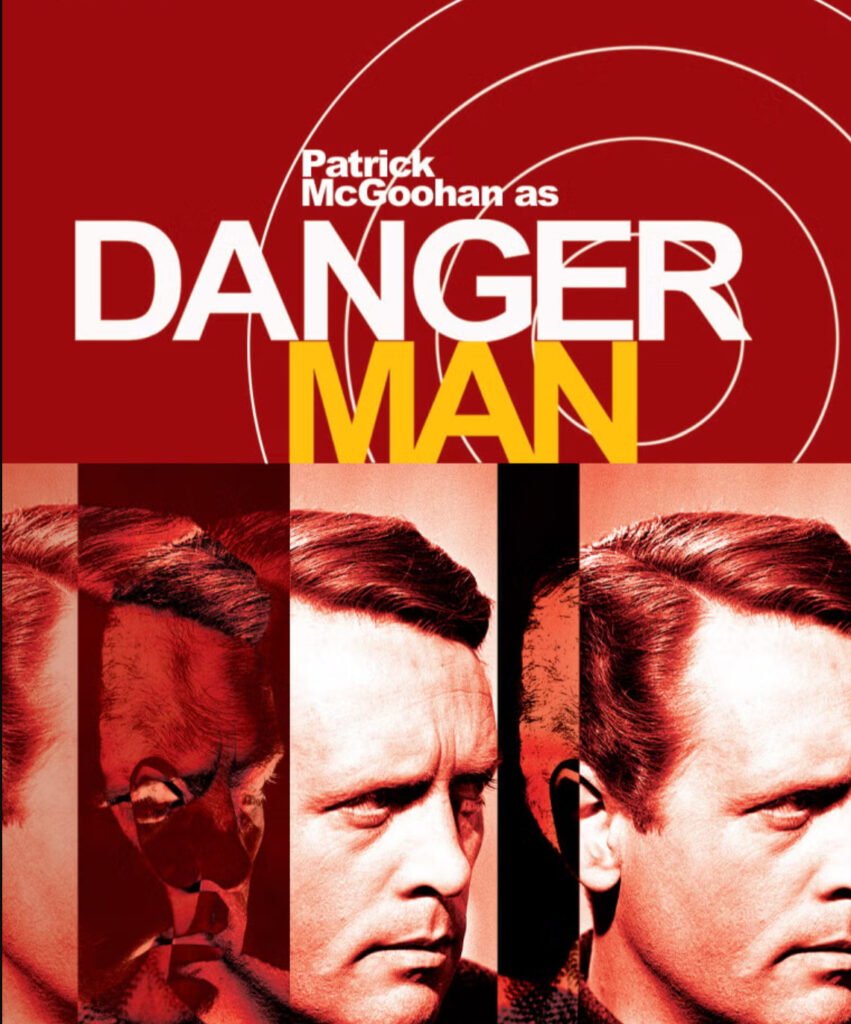
Le déroulement comprend deux étapes. La première est des plus classiques : Drake fonce en voiture à travers la forêt, en direction de la frontière. Il est bientôt poursuivi par Berg, qu’il sème provisoirement. Cette première phase n’est qu’un subterfuge, notre héros ayant volontairement signalé sa présence pour être sûr d’être pris en chasse. La seconde étape est bien plus originale : profitant de son avance, Drake abandonne sa voiture, court vers la clôture électrifiée et, avec l’aide d’une pince coupante et de complices positionnés juste en face, côté ouest, fait croire que c’est Lisa Lanzig qui vient de percer un trou dans le grillage et de traverser le no man’s land miné. Tout à sa hâte de l’arrêter, Berg, qui croit apercevoir la jeune femme à quelques dizaines de mètres, traverse lui-même la zone piégée, guidé par un soldat qui connaît la disposition des explosifs et – c’est là que le scénario perd en vraisemblance psychologique – continue sa traque effrénée côté ouest. Quand il s’empare enfin de sa proie et la plaque au sol, c’est sur lui que le piège se referme : la fuyarde n’était pas Lanzig mais un sosie qui guettait, derrière la clôture ouest, le signal de Drake pour se mettre à courir, et Berg est maintenant tenu en joue par des militaires britanniques qui l’attendaient de pied ferme. Quant à Drake lui-même, qui n’a jamais quitté l’Est, il n’a plus qu’à aller présenter sa proposition de marché au père de l’imprudent.
Dans cet épisode, le passage de la frontière est donc déroutant, à l’échelle de la scène-clé, quand Berg croit dominer la frontière puisqu’il évite les mines avec succès alors que chaque pas le rapproche de sa perte, et à l’échelle de tout le dernier acte puisque celui-ci culmine avec un premier franchissement mouvementé mais illusoire et se termine par un second, banal mais réel.
« I’m the boy who’s gonna cross the bloody thing! »,
Dans les trois épisodes que nous avons étudiés jusqu’à présent, le passage de la frontière n’occupe que le dernier temps du récit et les péripéties du retour vers le monde libre ne sont que les dernières d’une série. Avant de s’occuper de barbelés ou de gardes hostiles, McGill, Templar et Drake ont dû, pendant au moins une demi-heure, pourchasser, combattre, résister, se cacher, de telle sorte que le mouvement qui emporte le héros vers la frontière a été lancé dès le moment où il a été envoyé en mission voire plus tôt : « Fair Exchange », par exemple, s’ouvre sur une scène de poursuite – sans paroles – de presque trois minutes.
Avec Callan, nous avons affaire à un tout autre type de récit transfrontalier. « Heir Apparent » (s02e06) commence dans un cimetière par les funérailles de « Hunter », le chef de la Section, un service secret dont Callan est l’agent. L’épisode se poursuit par une série de discussions dans des intérieurs londoniens où l’on évoque le métier d’espion puis plus précisément la mission qui s’annonce. Callan est dûment briefé, fût-ce par des hommes déconnectés de la réalité du terrain, ce qui l’irrite rapidement : après tout, c’est lui et lui seul qui va devoir franchir cette fichue frontière. On est loin du Saint qui reçoit ses consignes en trois minutes dans les tribunes de Wimbledon avant de filer prendre son avion. Les 28 minutes restantes de « Heir Apparent » se déroulent à la lisière d’un bois, tout près du Rideau de Fer et plus précisément d’un bunker est-allemand désaffecté où Callan doit retrouver son nouveau supérieur, Ramsay, et l’exfiltrer.
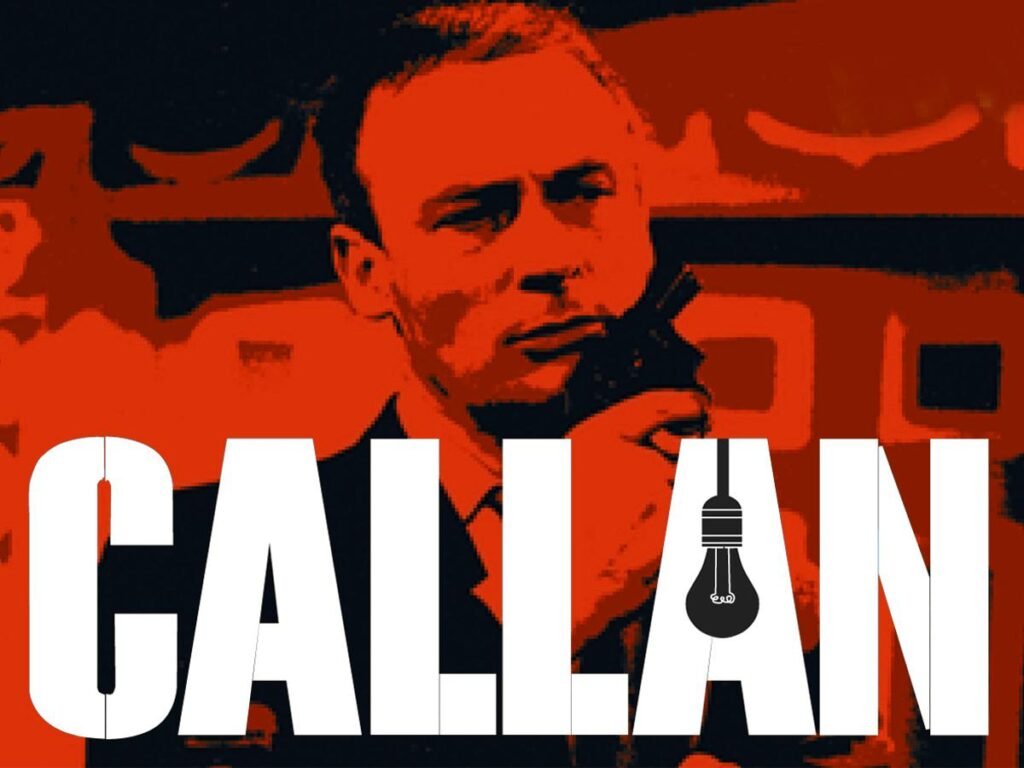
Ici, passer la frontière n’est plus une question de secondes, réglée en quelques coups d’accélérateur et de mitraillette, mais une question d’heures, entre attente et tentatives avortées. La difficulté de l’exercice et son caractère ingrat sont donc clairement exposés. Callan doit rebrousser chemin une première fois parce qu’un hélicoptère en patrouille pourrait le repérer et une deuxième fois parce que son coéquipier Meres le rappelle pour l’informer d’une évolution de la situation. Sa troisième tentative paraît aussi compromise quand apparaît un nouvel hélicoptère, et s’annonce carrément fatale quand survient en plus un serpent qui entreprend de glisser sur la jambe de Callan alors qu’il est couché dans l’herbe, obligé de rester immobile pour ne pas se signaler à l’ennemi. Notre héros parvient enfin au bunker où le rejoint Ramsay mais les deux hommes doivent encore attendre la nuit – et l’aide de Meres, qui crée une diversion – pour quitter leur cachette et re-traverser le no man’s land.
Au total, un épisode d’une grande sobriété (accentuée par le noir et blanc), et au budget sans doute serré, qui tranche en tous points avec les aventures de héros bondissants et dévoreurs de kilomètres.
Un rideau bien « noir »
On l’a vu, les quatre héros abordés successivement entretiennent un rapport particulier à la frontière et plus encore à l’évasion, puisque c’est ce mouvement de sortie (ou de retour, comme on voudra) qui les réunit. Seul Simon Templar alias “le Saint” considère celui-ci comme un jeu, dangereux mais palpitant et divertissant. Les trois autres héros se trouvent plongés à leur corps défendant dans une certaine noirceur (au sens de film noir) qui participe d’une vision désabusée de la guerre froide, un conflit dans lequel le Royaume-Uni ne joue finalement qu’un rôle subalterne et qui ne peut rivaliser en légitimité ni en épopée avec la Deuxième Guerre mondiale. Pour McGill, piégé, l’évasion est clairement un choix contraint, fait et assumé dans l’urgence et sans aucun plaisir. Pour John Drake, ce n’est qu’un défi froid, un challenge lancé à son intelligence, assez semblable d’ailleurs à ceux que devra relever Numéro 6 (interprété par le même Patrick McGoohan) dans Le Prisonnier, série d’évasion par excellence qui peut être vue comme une parabole de la guerre froide. Pour Callan, irascible et récalcitrant, l’évasion n’est qu’une corvée, un boulot de plus à faire. Encore ces trois personnages sont-ils préservés, in fine, de l’absurdité : par leurs qualités héroïques, ils font la différence et rétablissent, au moins un peu, la justice. Dans les années 1970, quand la raison d’être de la guerre froide et de ses expédients sécuritaires paraîtra encore plus contestable, le temps sera venu de mettre en scène un protagoniste véritablement privé de solutions, pour qui le franchissement de la frontière – par la femme qui l’aime – ne peut se solder que par un échec déchirant. C’est ce que raconte, en 1978, « Special Relationship », le plus poignant épisode de The Sandbaggers (s1e07).




